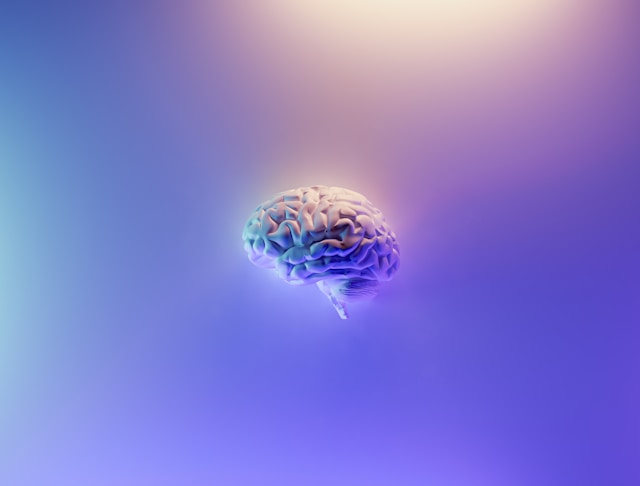Des chercheurs ont récemment mis en évidence, pour la première fois, des « biophotons » produits par le cerveau humain. Ils ont découvert que ces lueurs invisibles à l’œil nu variaient en fonction de l’activité neuronale. Leurs travaux ouvrent la voie à de nouvelles perspectives scientifiques.
C’est connu des croyants comme des scientifiques : tout être vivant émet de la lumière, visible pour certains et invisible pour d’autres. Ces lueurs de faible intensité prennent le nom de « biophotons » dans le domaine de la science. Pour décrire ce phénomène, les chercheurs emploient l’expression « émissions de photons ultrafaibles » (UPE, pour ultra-weak photon emissions, en anglais). Ils l’expliquent par des réactions métaboliques de l’organisme, lorsque des molécules excitées libèrent de l’énergie sous forme de lumière.
Une étude pour mesurer pour la première fois les « biophotons » produits par le cerveau humain
Si cette propriété biologique est connue des scientifiques depuis les années 1920, elle suscite aujourd’hui un regain d’intérêt, notamment pour son potentiel dans l’étude des fonctions cérébrales. C’est dans ce cadre que des chercheurs canadiens ont menée une étude visant à mesurer pour la première fois les « biophotons » produits par le cerveau humain. Ils ont découvert que les émissions de biophotons variaient en fonction des activités neuronales, sans pouvoir établir de relation claire.
Vingt personnes ont participé à l’étude avec des casques EEG
Dans leur étude publiée dans la revue iScience, Nirosha Murugan, biophysicienne à l’université Wilfrid-Laurier au Canada, et son équipe ont cherché à savoir s’il était possible de mesurer les UPE à la surface du crâne. À cet effet, ils ont équipé vingt participants de casques d’électroencéphalographie (EEG) et les ont placés dans une salle plongée dans le noir. Ils leur ont également mis autour de la tête des tubes amplificateurs de photons destinés à détecter les UPE.
« Les photons sortent de la tête »
Ces détecteurs étaient précisément posés du côté des lobes occipitaux (régions du cerveau situées à l’arrière du cerveau) et des lobes temporaux (situés de chaque côté du cerveau). Les premiers sont responsables du traitement visuel et les seconds du traitement auditif.
« Notre premier constat, c’est que les photons sortent de la tête, ça ne fait pas de doute », affirme Nirosha Murugan. Son équipe a ensuite voulu vérifier si l’intensité de ces émissions changeait en fonction du type de tâche cognitive effectuée par les participants. Ils s’attendaient à ce que l’intensité des UPE augmente lorsque les personnes exécutent des tâches nécessitant plus d’énergie, comme le traitement visuel.
De nombreuses incertitudes persistent quant au rôle des biophotons pour le cerveau
Dans les faits, les scientifiques ont mesuré des variations dans certaines régions du cerveau au moment où les participants changeaient de tâche, suggérant un lien entre les processus cognitifs et les émissions de biophotons. Si les résultats montrent une corrélation, le mécanisme précis reste à élucider. De nombreuses incertitudes persistent donc quant au rôle de ces biophotons. Les scientifiques ne savent pas par exemple si les UPE constituent un mécanisme actif de modification des processus cognitifs ou s’ils ne font que renforcer des mécanismes cognitifs connus.
Vers le développement d’une nouvelle technique d’imagerie pour les pathologies du cerveau
Pour les expériences futures, les chercheurs canadiens prévoient d’utiliser des capteurs plus précis afin de localiser l’origine des UPE dans le cerveau et leur fonction réelle. Des études antérieures suggèrent que les biophotons pourraient participer à la régulation de processus biologiques, comme la croissance cellulaire. Toutefois, leur implication dans la cognition humaine nécessite des travaux plus poussés.
Au-delà de ces préoccupations, les découvertes pourraient mener au développement d’une nouvelle technique d’imagerie, la photoencéphalographie, pour les pathologies neurodégénératives. Cette innovation compléterait l’EEG en apportant des données supplémentaires sur le métabolisme cérébral, sans recourir à des méthodes invasives.