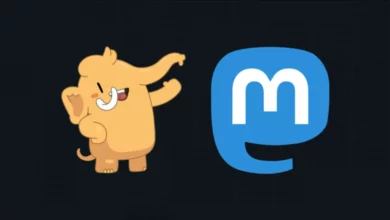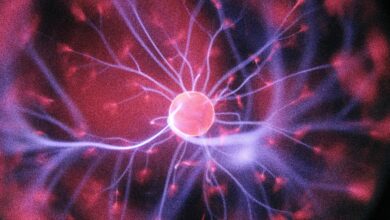Dans une tribune publiée en juin, l’entrepreneur ouest-africain Sidi Mohamed Kagnassi a rappelé que l’Afrique ne pourra pas assurer sa place dans la compétition mondiale sans souveraineté numérique. Un appel qui va bien au-delà d’un simple constat : il met en lumière l’urgence de développer des infrastructures critiques et de structurer une réponse collective panafricaine.
La souveraineté numérique, un enjeu stratégique
Avec 1,4 milliard d’habitants dont plus de 60 % ont moins de 25 ans, l’Afrique est un marché numérique en pleine explosion. Mais derrière ce dynamisme démographique se cache une réalité inquiétante : la dépendance aux technologies étrangères. Aujourd’hui, plus de 80 % du trafic Internet africain transite par l’Europe ou les États-Unis, et les géants américains et chinois détiennent la majorité des données stratégiques du continent.
Cette dépendance ne se limite pas aux applications ou aux réseaux : elle touche trois piliers fondamentaux de la souveraineté numérique – les infrastructures (datacenters, cloud, câbles sous-marins), la maîtrise des données (data governance, IA) et le financement de champions locaux. C’est cette hiérarchisation des priorités qui doit structurer le débat.
Les start-ups, un levier mais pas une panacée
Sidi Mohamed Kagnassi insiste sur le rôle central des start-ups africaines, et à juste titre : ce sont elles qui répondent aux besoins spécifiques du continent, là où les solutions importées échouent souvent. L’exemple de la kényane Amini.ai, qui a levé 4 millions d’euros pour développer des modèles d’anticipation climatique, illustre parfaitement cette dynamique. Dans un contexte de dérèglement climatique aigu, disposer d’outils africains de prévision agricole et environnementale est un enjeu de sécurité alimentaire, et pas seulement d’innovation.
De même, Aya Data au Ghana s’est spécialisée dans l’étiquetage de données pour l’IA, un métier clé, qui permet de construire une expertise locale indispensable à l’économie numérique. Ces initiatives montrent que les niches africaines ne sont pas marginales : elles répondent à des besoins vitaux (climat, agriculture, gouvernance des données) et peuvent constituer des relais de souveraineté.
Mais la critique de Sidi Mohamed Kagnassi est claire : tant que ces start-ups dépendent majoritairement de financements étrangers, elles risquent de rester fragiles et captives. Le véritable enjeu est donc de créer un écosystème de capital-risque panafricain, adossé à des fonds souverains et des banques régionales, capable de soutenir ces pépites au-delà des premiers tours de table.
Le cloud, véritable colonne vertébrale
La souveraineté numérique africaine ne se gagnera pas seulement sur les applications, mais dans les infrastructures invisibles. Le cloud souverain est ici le champ de bataille décisif. Sans serveurs locaux, sans contrôle de l’hébergement et des flux de données, l’indépendance restera un slogan.
L’exemple de ST Digital au Cameroun, qui propose un cloud souverain depuis 2024, est révélateur : il ne s’agit pas seulement d’hébergement, mais de doter chercheurs, administrations et entreprises d’outils compétitifs. Le Togo, avec Cloud Inspire, suit une logique similaire en misant sur l’open source. Ces projets montrent que des solutions techniques existent, mais qu’elles manquent de masse critique pour rivaliser avec AWS, Microsoft Azure ou Alibaba Cloud.
La leçon à tirer est claire : au lieu d’une multitude de micro-initiatives isolées, l’Afrique doit mutualiser ses efforts pour bâtir deux ou trois grands pôles régionaux de cloud souverain, capables d’assurer la redondance, la sécurité et la compétitivité.
L’équation financière, nœud du problème
La contraction des investissements est un signal d’alarme. Après 6 milliards de dollars levés par les start-ups africaines en 2022, les montants ont reculé de 46 % en 2023, puis encore de 7 % en 2024. Dans un continent où l’accès au capital était déjà limité, cette baisse fragilise toute la dynamique d’innovation.
C’est pourquoi l’appel de Sidi Mohamed Kagnassi à mobiliser les fonds souverains africains, et les banques régionales. Les success stories comme Flutterwave ou Jumia ont montré que des start-ups africaines pouvaient atteindre une envergure internationale. Mais faute de financements locaux robustes, elles se tournent vers Londres, New York ou Singapour – et avec elles, les sièges sociaux et la propriété intellectuelle.
Une vision panafricaine indispensable
Au-delà de l’analyse économique, l’enjeu est politique. La souveraineté numérique n’est pas qu’un débat technique : elle conditionne la capacité des États africains à protéger leurs données sensibles, à négocier d’égal à égal avec les big techs, et à garantir que l’innovation serve d’abord leurs citoyens.
La Côte d’Ivoire, le Ghana ou le Sénégal ont pris des initiatives nationales ambitieuses, mais elles restent fragmentées. Comme le souligne Sidi Mohamed Kagnassi, seule une approche panafricaine – intégrant gouvernements, entreprises, universités et diaspora – permettra de transformer ces efforts isolés en véritable puissance collective.
La tribune de Sidi Mohamed Kagnassi rappelle que la souveraineté numérique africaine est à la fois une nécessité stratégique et une opportunité historique. Les talents sont là, les start-ups innovent, et les États commencent à investir. Mais sans mutualisation panafricaine, le risque est de rester dépendant des flux étrangers.
La question n’est donc plus de savoir si l’Afrique doit s’émanciper, mais comment et à quelle vitesse. Le temps presse : d’ici 2050, un quart de la population mondiale vivra sur le continent. Si l’Afrique veut peser dans la gouvernance numérique globale, elle doit construire ses propres champions dès aujourd’hui.