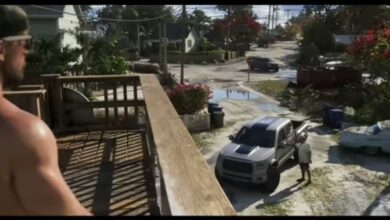Au Kirghizistan, une équipe d’archéologues russes a mis au jour les vestiges d’une cité engloutie sous les eaux du lac Issyk-Koul, l’un des plus grands et vieux au monde. Elle a découvert des structures en briques cuites et des récipients en céramique, notamment. La nécropole semble avoir été un important centre commercial sur la Route de la soie, qui reliait l’Asie à la Méditerranée.
Est-ce l’Atlantide de l’Asie mineure ? Au Kirghizstan, une ex République soviétique située entre le Kazakhstan et la Chine, une équipe d’archéologues russes a mis au jour une cité médiévale engloutie dans les eaux de l’Issyk-Koul, dans le nord-est du pays. Situé à 1 600 m d’altitude dans les monts Tian Shan, ce lac est l’un des plus anciens au monde (vieux de 25 millions d’années). Il est aussi l’un des plus grands avec 182 km de longueur et jusqu’à 61 km de largeur, pour une superficie de 6 280 kilomètres carrés.
Des meules à grains, des jarres, des poutres en bois et des outils
En fouillant ses profondeurs à moins de trois kilomètres au large de la rive nord-ouest, les chercheurs de l’Académie des sciences russe ont trouvé des bâtiments en briques effondrés. Certaines de ces constructions contenaient encore des meules à grains, des jarres, des poutres en bois et des outils relativement bien conservés.
En creusant encore plus profondément, les scientifiques ont identifié ce qui ressemble à un bâtiment public important, qui aurait pu abriter une mosquée, des bains publics ou une madrasa (un centre d’étude coranique). Ils ont en outre repéré un cimetière dans lequel gisaient des squelettes bien préservés et disposés selon les rites funéraires islamiques, le corps orienté vers le nord et le visage tourné vers la Mecque.
La cité engloutie était un carrefour sur la Route de la soie
Le New York Post décrit cet ensemble comme une « immense nécropole musulmane du XIIIe siècle rattachée à la ville ». Pour les chercheurs à l’origine de la découverte, ce site baptisé Toru-Aygyr aurait pu servir de halte aux voyageurs et aux marchands traversant la légendaire Route de la soie, reliant l’Asie à la Méditerranée, (et principalement la province actuelle chinoise du Xi’An à Rome ou encore Constantinople). Ils en veulent pour preuve le fait que l’artère principale traverse le complexe d’est en ouest. Notons que la Route de la soie était une route commerciale et culturelle active pendant plus de 1 500 ans, du IIe siècle avant J.-C. au milieu du XVe siècle, selon les estimations.
La cité engloutie par un tremblement de terre
En tant que carrefour du commerce entre l’Asie et la Méditerranée, la nécropole engloutie permettait probablement aux marchands d’échanger les richesses les plus convoitées au monde en ce temps : soie, épices, métaux… et même des idées. Selon Valery Kolchenko, chef de l’expédition et membre de l’Académie nationale des sciences de la République kirghize, cette cité prospère a pris « brutalement fin » lorsqu’un immense tremblement de terre l’a secouée jusqu’à ses fondations, provoquant son effondrement et son immersion sous le lac.
C’est un peu comme Pompéi, la ville italienne ensevelie lors d’une violente éruption du Vésuve en l’an 79. Tous les habitants ont été pétrifiés par la cendre volcanique. Ceux de la cité kirghize auraient eu plus de chance car ils auraient quitté les lieux au moment de la catastrophe. Des tribus nomades auraient pris possession des ruines par la suite. Une hypothèse que pourraient confirmer l’analyse des premiers artefacts.